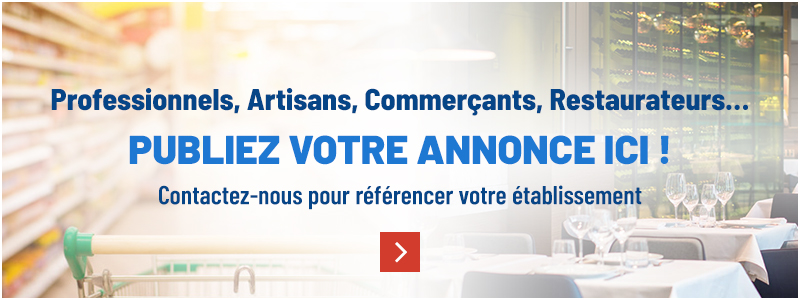Les Mees
Les Mées
Les infos clés
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Département Alpes-de-Haute-Provence
Code postal 04190
Gentilé Méens
Habitants 3 700 (2015)
Densité 57 hab./km2
Altitude minimum 348 m
Altitude maximum 824 m
Superficie 65,4 km2
En quelques mots...
Les Mées est située dans la vallée de la Durance, en rive gauche, entre Sisteron et Manosque. La commune s’étend sur la vallée de la Durance et le rebord occidental du plateau de Valensole, dont le poudingue forme les curieuses formations géologiques appelées Pénitents. La commune compte 2 616 ha de bois et forêts, soit 40 % de sa superficie. La commune comporte de nombreux hameaux et lieux-dits, dans sa partie en aval sur la vallée de la Durance, dont Dabisse est le plus important.
La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle : Metas et Las Medas en 1098. L’abbaye Saint-Victor de Marseille y possédait, au XIe siècle, le prieuré Saint-Antoine. L’abbaye de Boscodon y possédait le prieuré de Paillerols à partir du XIIe siècle. Après le XVe siècle, les moines n’y sont plus présents, et le prieuré est transformé en exploitation agricole. L’abbaye de Boscodon possédait aussi le prieuré Saint-Blaise (actuelle chapelle Saint-Honoré). Le prieuré de Ganagobie y possédait la chapelle Saint-Michel, et percevait les revenus afférents.
Une place forte se constitue au Moyen Âge. Elle a ses syndics au XIIIe siècle. Le fief des Mées est acheté par le comte de Provence en 1345, avant d’être intégré à la vicomté de Valernes en 1353 ; puis, du XIVe au XVIe siècle, le fief est partagé entre Montfort et Beaufort. La communauté relevait de la baillie de Digne. Un consulat lui est accordé en 1560.
Le canal du Moulin est creusé au XIIe siècle. Il permet d’irriguer la plaine jusqu’à Oraison. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1348. Également à la fin du Moyen Âge, un péage est prélevé sur la route allant vers la vallée de la Bléone et Digne, qui était très fréquentée et avait été interdite aux marchands du comté de Forcalquier par le comte. La richesse de la commune venait également de la production de l’huile d’olive : l’église était appelée Sainte-Marie-de-l’Huile ou Sainte-Marie-de-l’Olivier.
En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses États napolitains, elle vendit Avignon au pape pour 80 000 florins, et obtint au passage l’absolution pontificale qui la lavait de tout soupçon dans le meurtre de son premier époux André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume II Roger, frère du pape, le fief de Valernes, qui fut érigé en vicomté par lettres patentes en 1350. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayons, Vaumeilh, la Motte, Bellaffaire, Gigors, Lauzet, les Mées, Mézel, Entrevennes et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances.
En 1571, la communauté engage Adam de Craponne pour construire une nouvelle prise d’eau sur la Bléone alimentant le canal d’irrigation. Les terres du bord de la Durance et de la Bléone appartenaient à l’Église (plusieurs centaines d’hectares) et étaient irriguées (par les eaux du canal du Moulin). Afin de maintenir son influence, elle entretient jusqu’à 18 prêtres dans le village. La Réforme connaît un certain succès aux Mées et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l’édit de Nantes (1598). Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement et de l’évêque, entraînèrent sa disparition avant le début du règne personnel de Louis XIV (1660). En 1649, lors de la Fronde, le village se révolte en soutien au parlement de Provence. Il est maté par un régiment de cavalerie de Digne et paie 6 000 livres d’amende. Une foire s’y tenait au XVIIIe siècle.
La culture de l’olivier est une culture importante aux Mées, de manière ancienne. L’oliveraie occupait 296 ha en 1820, sur la terrasse dominant la Durance. La production d’huile d’olive était très importante jusqu’au début du XXe siècle avec 50 000 pieds en 1929, avant de connaître un déclin assez marqué au XXe siècle, qui se termine avec seulement 30 500 pieds en 1994. Ce repli est cependant moins marqué que dans le reste du département. Depuis le début des années 1990, le renouveau de l’oliveraie a été subventionné par le ministère de l’Agriculture. Des arbres qui n’étaient plus exploités ont aussi été remis en culture. En 2005, l’oliveraie atteignait les 386 ha et 63 000 arbres. L’huile d’olive est extraite dans un des deux moulins de la commune, l’un étant privé et l’autre coopératif. Outre son rôle économique, l’oliveraie peut aussi jouer un rôle de limitation des incendies de forêt, en tenant le rôle de pare-feu. Les oliviers ont aussi un aspect patrimonial : certains oliviers de la commune dépassent les 200 ou 300 ans.
La viticulture est également ancienne aux Mées : son vin était réputé du XVIe au XIXe siècle. La vigne occupe de 1853 à 1880 plus de 800 ha, produisant un vin de garde destiné à la consommation locale et à la commercialisation régionale. Le vignoble des Mées connaît un effondrement après la crise du phylloxéra, avec 235 ha en 1929, 76 en 1956 et deux hectares en 2000. La baisse de qualité accompagne l’effondrement des surfaces exploitées : en 1956, 72% des ceps sont des hybrides ou des cépages interdits. Les surfaces cultivées sont divisées en parcelles minuscules, d’un demi-hectare en moyenne, ce qui explique conjointement la disparition du vignoble : il était devenu un vignoble d’autoconsommation, auquel les exploitants ne consacraient pas les soins nécessaires.
Le premier pont suspendu sur la Durance est construit en 1841-1843, pour remplacer le bac du Loup, en face de Ganagobie. Concédé à une société privée, la Société du Pont, il est emporté en 1843 par une crue de la Durance le jour de son inauguration. Le bac est remis en service jusqu’en 1857 et la mise en service d’un nouveau pont sans péage, décidée en 1846. Il est alors constitué de deux travées de 82m de long, supportant un tablier de 5m de largeur, en mélèze. Il est testé à l’épreuve de seize wagons remplis de pierre pesant 82,2t. En 1878, la circulation est limitée à une voiture de moins de trois tonnes à la fois, puis il est renforcé de câbles supplémentaires en 1904, et restauré en 1941. Le bombardement par les alliés, les 15 et 16 août 1944, échoue, et fait cent morts à Digne et Sisteron. La Résistance se charge alors de détruire une travée. Après la guerre, une passerelle piétonne provisoire est établie, avant la construction d’un nouveau pont en poutre en treillis de type Waren, en 1952-1956. Ce pont, qui est l’actuel pont, est long de 172m, avec une chaussée de 6m de large et des trottoirs de un mètre.
Les rues du village offrent quelques maisons de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Rue Font-Neuve se trouve une porte sculptée d’éléments architectoniques (mi XVIIe siècle). L’ancienne mairie et tribunal possède une cheminée de gypserie ornée de motifs floraux. L’hôtel Latil d’Entraigues, ou hôtel de Trimond, possédait des rosaces aux plafonds, des dessus-de-porte en gypserie, déposés ou cachés par une restauration. L’hôtel de Crose est un monument historique inscrit depuis 1989.
Les numéros utiles
Mairie
04 92 34 03 01
Médiathèque Municipale
04 92 34 30 95
Foyer Club
04 92 34 16 12
Espace Jeunes
04 92 34 12 11
Camping municipal
04 92 34 33 89
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains)
04 92 36 72 00
Conseil Général des-Alpes-de Haute-Provence (Digne-les-Bains)
04 92 30 04 00
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille)
04 91 57 50 57
Office de Tourisme
04 92 34 36 38